Dans son célèbre livre Les origines du totalitarisme (1951), Hanna Arendt a écrit :« «Le sujet idéal de la domination totalitaire n’est ni le nazi convaincu ni le communiste convaincu, mais celui pour qui les distinctions entre fait et fiction et entre vrai et faux n’existent plus » Hannah Arendt « Les origines du totalitarisme » (Gallimard, p. 832). « Le fascisme est vainqueur, disait-elle, quand les hommes refusent de croire à la véracité d’une chose, même quand les faits la confirment ». Selon elle, mentir et convaincre la société de ces mensonges est le fondement du succès des idéologies fascistes.

Après 20 ans de pouvoir, les gouvernements successifs du Centre démocratique ont montré leur nature autoritaire, leur rapport pour le moins ambigu avec la Justice et l’utilisation récurrente de mensonges politiques pour vaincre l’adversaire. Cependant, après l’accession à la présidence d’Ivan Duque et, plus encore, après la récente mise aux arrêts domiciliaires d’Álvaro Uribe, la militarisation de la politique, la criminalisation de l’opposition et de la contestation, la concentration des organes de contrôle dans les mains du parti gouvernemental, le discours xénophobe et la censure des médias, même internationaux, sont de moins en moins cachés. À cela s’ajoute le lancement d’une campagne internationale pour discréditer l’opposition politique en Colombie avec Donald Trump pour porte-parole.
Pour certains critiques du gouvernement, ces actions indiquent une érosion imminente de l’État de droit. Pour d’autres, ces actions sont la preuve de la montée dangereuse du fascisme en Colombie. Bien que certains historiens aient écrit sur l’influence du fascisme européen sur certains politiciens conservateurs de la première moitié du XXe siècle, tels que Laureano Gómez vers les années 30, ou le groupe de jeunes appelés les Leopardos une décennie plus tôt, contrairement à d’autres pays d’Amérique latine, le terme fascisme n’a pas été utilisé de façon récurrente dans le langage politique en Colombie. Jusqu’à présent.
Cela a-t-il un sens de parler du fascisme en Colombie ? Est-ce irresponsable ou au contraire urgent ? Il y a quelques jours, j’ai eu une conversation avec deux historiens reconnus sur le plan international pour leurs publications sur le fascisme, la violence politique et la sphère publique :

Federico Finchelstein est professeur d’histoire à la New School of Social Research et est considéré aujourd’hui comme l’un des chercheurs les plus importants sur le fascisme au monde. Il est l’auteur de sept livres sur le sujet, dont Fascismo transatlántico: ideología, violencia y lo sagrado en Argentina e Italia, 1919-1945, et Del fascismo al populismo en la historia . Il vient également de publier un livre édité par L’Université de Californie, qui circulera bientôt en espagnol, intitulé Breve historia de las mentiras fascistas.
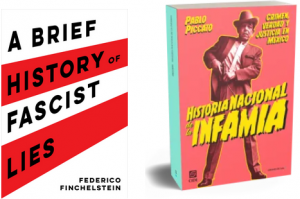
Pablo Piccato est professeur d’histoire à l’Université de Columbia et spécialiste de l’histoire du crime, de la violence politique et de la formation et de la crise de la sphère publique en Amérique latine. Il est l’auteur de livres tels que La tiranía de la opinión: El honor en la construcción de la esfera pública en México, traduit en espagnol en 2017, et Historia nacional de la infamia: crimen, verdad y justicia en México, publié en espagnol cette année.
Dans cet entretien, nous discutons de l’influence du fascisme sur les populismes latino-américains de la première moitié du XXe siècle, de la manière dont l’histoire peut aider à comprendre non seulement les fascismes du passé, mais les changements récents dans les manières de faire de la politique, et la montée dangereuse aujourd’hui de ce qu’on a appelé des « populismes postfascistes » . Ces historiens concluent qu’il ne faut pas avoir peur d’utiliser le terme si ce que l’on considère est l’emploi de stratégies fascistes et la dangereuse montée du fascisme aujourd’hui. Selon eux, le fascisme du XXIe siècle n’aura peut-être pas le visage de Mussolini, d’Hitler ou de Franco, mais il serait faux d’en déduire que les démocraties ne sont pas en danger. Cet entretien rappelle une leçon fondamentale de l’histoire du fascisme, à savoir que la démocratie peut être détruite de l’intérieur.
Dans vos récents articles publiés dans la presse aux USA, au Mexique et en Argentine, vous avez attiré l’attention sur l’importance et la pertinence de parler aujourd’hui de fascisme. Pourquoi pensez-vous qu’il est logique d’utiliser un terme considéré comme polémique, voire excessif, pour décrire certaines façons de faire de la politique aujourd’hui ?
F. F. : Le travail que nous avons fait en tant qu’historiens, mais aussi ce que nous voyons dans la politique récente, nous montre qu’il y a sans aucun doute une dangereuse montée du fascisme aujourd’hui. Ce danger est planétaire et se vérifie évidemment aux USA, mais aussi au Brésil, en Hongrie, en Inde, et la question de ce qui se passe en Colombie ne doit pas être écartée a priori. Nous avons constaté chez les historiens une énorme résistance à l’emploi de ce concept. Aux USA, par exemple, des historiens à la vision ethnocentrique ont postulé de fait l’impossibilité de penser l’histoire nationale en termes de fascisme.
P. P. : C’est justement un des problèmes que nous avons pour comprendre ce qui se passe actuellement dans ces pays. Personne ne veut utiliser le concept de fascisme, et ne pas l’utiliser nie la possibilité d’identifier certaines de ses caractéristiques dans les régimes démocratiques au pouvoir aujourd’hui. L’un des arguments utilisés par ceux qui éludent cette question aux USA, par exemple, est que ce pays est unique, et a sa propre histoire de la démocratie, qui ne lui ressemble dans aucun autre pays, et qu’il est donc impossible que puissent s’y produire des processus de dégradation de la démocratie de l’intérieur, ou qu’y émergent des mouvements violents tels que le fascisme. Ces affirmations perdent leur poids, au moins depuis la victoire de Trump. Mais il existe aussi l’idée, très courante chez les historiens européens, que le fascisme ne s’est produit qu’en Italie et en Allemagne, et que parler de fascisme en tout autre lieu ou circonstance relève d’un abus puéril de ce mot ou d’une approche très superficielle des problèmes des régimes actuels. Nous pensons, premièrement, qu’il ne faudrait pas se limiter aux cas historiques de l’Italie et de l’Allemagne pour comprendre le fascisme, et que, deuxièmement, parler de fascisme ne signifie pas nécessairement parler de l’existence d’un régime fasciste.
Alors, comment caractériseriez-vous un régime fasciste, ou à quelles conditions faut-il le considérer comme tel ?
F. F. : le fascisme est beaucoup de choses : c’est un mouvement politique, une idéologie et, éventuellement, dans certains pays, un régime. Un régime fasciste est un régime totalitaire dans lequel il n’y a pas de divisions entre le privé et le public, entre l’État et le gouvernement, et entre l’État et la société civile. Dans ces régimes, la sphère publique est fermée, la liberté d’expression disparaît et il n’y a bien sûr pas de presse indépendante. Le racisme, la xénophobie, l’homophobie et la misogynie deviennent des politiques étatiques, et la violence n’est pas seulement glorifiée, mais mise en pratique. Pour les fascistes, la violence produit et témoigne du pouvoir. Selon Max Weber, un État puissant et légitime est un État qui a le monopole de la violence, mais ne l’exerce pas. C’est pourquoi, par exemple, on a dit que l’ État colombien est un État faible, car il exerce constamment la violence. Les fascistes ne sont pas d’accord avec cette notion wébérienne de la légitimité, car pour eux la légitimité ne réside pas seulement dans le monopole de la violence, mais dans son exercice, y compris de manière extrême. Cette idée de pouvoir conduit naturellement à la répression intérieure, et avec elle à des disparitions, des exécutions, des emprisonnements et éventuellement à une guerre extérieure. Mais en plus de la suppression de la sphère publique, de l’exacerbation du racisme et de la xénophobie qui crée un ennemi interne et de la glorification de la violence, il y a deux autres conditions pour parler de l’existence d’un régime fasciste. D’une part, une politique impérialiste, qui consiste à se penser non seulement supérieur à d’autres pays, mais à agir pour les dominer, et de l’autre, l’utilisation de la technique de propagande totalitaire. Dans le fascisme le mensonge n’est pas seulement une stratégie de manipulation, mais une croyance. Le mensonge remplace la vérité et on croit en une vérité qui transcende l’empirique, parce qu’elle fait partie d’une religion politique, le culte du chef porté à un fanatisme extrême. La somme de ces conditions décrit un régime fasciste.
P. P. : Je voudrais ajouter que l’identification du mouvement au leader est aussi un trait fasciste.
F. F. : Oui. C’est juste. Au début, il y a une identification entre le mouvement et le chef. Ensuite, il y a une identification entre le mouvement, le chef et l’État, et enfin une identification totale, ce que j’appelle « une trinité » — un concept religieux bien sûr — entre le chef, la nation et le peuple. Je veux dire, tout est le leader. Ce qui se produit, c’est la personnalisation totale de la politique, de la nation, du peuple et de l’État dans la personne du chef. Tout passe par le chef tout-puissant et omniscient, qui sait tout et qui pense savoir ce que veut le peuple.
Federico, tu dis, dans ton livre Del fascismo al populismo en la historia, que le populisme du milieu du XXe siècle est clairement d’inspiration fasciste, c’est-à-dire que c’est un dérivé en « mode démocratique » du fascisme. Qu’est-ce qui a différencié le populisme du fascisme dont il est issu et quels aspects en ont été maintenus ?
F. F. : Ici, je vais parler très brièvement d’une longue histoire. Après 1945, beaucoup de fascistes et de dictateurs du monde entier ont compris que le fascisme avait perdu la partie et que le monde tripolaire, dans lequel le libéralisme, le communisme et le fascisme se disputaient le pouvoir, était devenu bipolaire. Les fascistes ont ensuite essayé de se reformuler sur le mode démocratique en créant le populisme en tant que régime. La montée et la chute des fascismes ont affecté non seulement ceux qui avaient été fascistes, tels que Juan Domingo Perón en Argentine, mais aussi de nombreux dirigeants autoritaires, tels que Getúlio Vargas au Brésil. Ces premiers régimes populistes latino-américains d’après-guerre ont pris leurs distances avec le fascisme, mais ont conservé des traits antidémocratiques qui n’avaient pas prédominé dans les mouvements pré-populistes et proto-populistes d’avant la Seconde Guerre mondiale. En s’adaptant au monde d’après-guerre, les populistes ont récupéré la démocratie en créant un hybride : l’autoritarisme démocratique, pour ainsi dire. La personnalisation de la politique et la tendance à gommer les différences entre le leader, le peuple et la nation, ont continué avec le populisme, mais sur un mode démocratique. Quatre éléments ont été abandonnés : la dictature fasciste proprement dite, la violence politique comme axe et source du pouvoir politique, le racisme ou la xénophobie comme politique de parti et, enfin, les mensonges extrêmes, caractéristiques de la propagande totalitaire.

Ce que nous voyons aujourd’hui aux USA avec Donald Trump, au Brésil avec Jair Bolsonaro, en Hongrie avec Viktor Orbán ou en Inde avec Narendra Modi, serait alors la résurgence des caractéristiques du fascisme dans les régimes démocratiques, dont certains sont populistes. S’agit-il alors d’un virage opposé à celui qui s’est produit après 1945 ? Comment et pourquoi cela arrive-t-il maintenant ?
P. P. : Les changements dans l’économie mondiale et la manière dont les économies et les populations de pays plus ou moins industrialisés sont plus interconnectées ont provoqué des réactions de défense dans certaines sociétés. L’ultra-droite profite de cette situation. Ces dernières années, nous avons vu, en particulier en Europe et aux USA, comment l’extrême droite utilise la xénophobie et le racisme pour obtenir des gains électoraux dans des secteurs qui se sentent menacés, par exemple par les migrants. L’ultra-droite utilise les immigrants et les réfugiés qui fuient les guerres civiles et les catastrophes environnementales comme prétexte. Dans le cas des USA, cet aspect du programme de Trump s’est exprimé à travers le racisme contre les Mexicains et l’obsession de construire un mur à la frontière. Cela a également permis de donner de la cohésion à des groupes armés d’extrême droite, qui existaient déjà et avaient déjà utilisé le terrorisme, mais qui considèrent maintenant Trump comme leur chef. Enfin, l’expansion des réseaux sociaux tels que Facebook a permis la diffusion de théories du complot et de mensonges que la presse traditionnelle aurait au moins retardés. Tout cela a produit une combinaison de forces qui met en péril la démocratie elle-même, et pas seulement aux USA.
F. F. : Ce que nous voyons dans les faits à présent, c’est un retour des populistes aux éléments centraux du fascisme, mais dans le cadre de la démocratie. Ce sont encore des populismes, parce qu’ils le font en démocratie, mais ce qui est nouveau, c’est qu’ils reprennent des traits du fascisme qui ne semblent plus tabous. Ce que le populisme avait éliminé après la Seconde Guerre mondiale revient. Le danger commence à être visible lorsque le discours du chef et de son parti est xénophobe, lorsque lui et son parti mentent pour créer un ennemi interne et le criminaliser, et lorsque la politique est militarisée et que la violence est exaltée comme stratégie de pouvoir et d’ordre. Trump a un discours résolument raciste. Dans ses premiers discours en tant que président, il a affirmé que les Mexicains étaient des violeurs et représentaient un grand danger pour les USA. Bolsonaro est indubitablement homophobe, misogyne et raciste, et les exemples abondent. Ce que nous ne voyons pas encore dans ces gouvernements, c’est la dictature. La dictature serait ce qui nous permettrait de dire que des gens comme Trump ou comme Bolsonaro, ou comme Uribe, sont fascistes. Mais qu’ils ne soient pas les dirigeants d’un régime fasciste déjà constitué ne signifie pas qu’il n’y a pas de danger de fascisme. Le fascisme d’aujourd’hui représente un danger différent de celui qui a créé l’univers d’Auschwitz. Ses assassinats ne sont peut-être pas organisés uniquement par l’État, mais son influence est énorme : le président et son parti ont une portée inattendue et globale grâce à laquelle des arguments et des raisonnements, comme quoi ce sont des fascistes sont constamment repris. Bien que les gouvernements des deux côtés de l’Atlantique semblent dans certains cas n’avoir aucun lien direct avec les actes quotidiens de violence, ils sont responsables moralement et éthiquement de favoriser un climat de violence fasciste.
Procédons par ordre. La xénophobie est donc la preuve de la montée possible d’un régime fasciste lorsqu’elle pénètre le discours d’un chef et de son parti. L’une des stratégies fascistes consiste-t-elle alors à créer un ennemi intérieur qui, je suppose, n’est pas nécessairement défini par sa race ou son ethnie, mais aussi par son idéologie ?
P.P. : Oui, il est important de se rappeler que les mouvements fascistes sont nationalistes et différents dans chaque pays, chacun revendiquant sa propre identité nationale, et ce n’est donc pas strictement une question de race. Bien que l’ennemi puisse être différent, un phénomène récurrent en Amérique latine est l’utilisation de la violence pour anéantir l’ennemi et aussi la criminalisation d’un certain secteur de la population. Aux USA, il y a évidemment le discours raciste, mais il y a aussi les attaques contre les journalistes, les immigrants, les musulmans et les mouvements de protestation, tous déjà devenus la cible de menaces de la part de la Maison Blanche. Ces groupes sont considérés comme des délinquants, des sous-hommes en quelque sorte, et la violence à leur encontre finit par être jugée appropriée. Je pense qu’il faut en tenir compte quand on pense à la Colombie. Nous devrions commencer à soupçonner des stratégies fascistes si un ennemi interne abstrait est créé qui prend forme dans des acteurs ou des personnes spécifiques. L’ennemi peut être personnifié par des immigrants des pays voisins, ou par une version déformée du socialisme, ou par l’invention du « castro-chavisme » ou des nouvelles FARC. C’est un ennemi imaginaire, qui finit par inclure tous ceux qui remettent en question le leader : les membres des partis d’opposition, les médias ou les organisations de défense des droits humains, même s’ils ne partagent pas nécessairement une même idéologie. Cet ennemi commun est d’abord créé, puis stigmatisé et persécuté, et enfin doit être éliminé.
Cet ennemi interne est créé à partir de ce qu’on nomme les « mensonges fascistes ». En quoi les mensonges fasciste sont-ils particuliers et différents des mensonges » des politiciens en général ?
F. F. : Pour parler simplement, tous les politiciens mentent, mais la différence entre un politicien communiste, libéral, socialiste ou conservateur et un politicien fasciste est que le politicien fasciste croit en ses mensonges. Même lorsqu’il reconnaît qu’il y a des mensonges dans son discours, il pense qu’ils sont au service d’une vérité transcendante et absolue qui, de plus, n’a pas à être démontrée. Autrement dit, c’est la vérité du chef omniscient. Dans mon dernier livre, j’évoque ces idées dans différents fascismes du XXe siècle, de la Colombie à l’Argentine, de l’Italie à l’Allemagne, de l’Inde au Japon, en essayant de comprendre comment le chef et ses disciples présentent ces mensonges comme des vérités qui n’ont pas besoin d’être vérifiées car elles ont trait à la foi. C’est la vérité d’une religion, d’un culte politique. Un Francisco Franco a pu dire une chose aussi contradictoire que « la vraie démocratie » était représentée par sa dictature. Pour ses disciples, il n’y avait pas de contradiction apparente, car les fascistes remplacent la théorie de la représentation par la théorie de la délégation absolue, qui est la délégation de la foi en un mythe vivant, soit, pratiquement, un dieu sur Terre.
L’un des cas les plus absurdes et, en même temps, symptomatiques de cette idée de vérité est celui des Protocoles des Sages de Sion. Les Protocoles sont un gros mensonge antisémite. Ils posent l’idée que dans un cimetière de Prague, des rabbins se sont rencontrés, non seulement des rabbins vivants, mais aussi des rabbins morts, pour planifier la domination du monde. Capitalisme, communisme, tout est expliqué à partir de cette rencontre dont quelqu’un a censément été témoin. Bref, c’est un grand fantasme qui finit par être cru par beaucoup. On a demandé un jour à Hitler s’il croyait aux protocoles, et celui-ci a répondu que, que l’un de ses éléments soit véridique ou non, les protocoles parlaient d’une grande vérité, qui bien sûr était réelle.
Un autre élément que je voudrais ajouter est peut-être l’un des plus inquiétants : pour les fascistes, comme l’a dit Hannah Arendt, il ne suffit pas de dire des mensonges et de les promouvoir dans le cadre de la propagande d’État : ils essaient en plus de changer la réalité quand elle ne coïncide pas avec leurs mensonges. La xénophobie créée par des mensonges a conduit, par exemple, à l’Holocauste. Les fascistes disaient, par exemple, que les Juifs étaient sales et que pour cette raison ils étaient contagieux. Ils ont ensuite soumis les Juifs à des mesures antihygiéniques et à la sous-alimentation dans les camps de concentration et les ghettos. Finalement, les Juifs sont tombés malades et sont devenus porteurs de maladies, et les nazis ont pu confirmer ce qu’ils avaient dit était vrai. Ils ont créé des situations artificielles telles que les ghettos et les camps de concentration pour que le mensonge devienne réalité.
Et enfin— et c’est une leçon que l’histoire du fascisme nous enseigne—, les mensonges racistes ou les mensonges qui créent un ennemi commun conduisent irrémédiablement à la violence politique extrême. Nous devons prêter attention à l’histoire des idéologies fascistes et à la manière dont elles ont conduit à l’Holocauste, par exemple. Comment les nazis ont-ils ôté la vie à tant de gens ? Ils l’ont fait en mentant. Le pouvoir politique des fascistes découle en grande partie de la cooptation de la vérité et de la généralisation du mensonge. Ce que nous devons comprendre aujourd’hui, c’est que les mensonges qui ont produit une telle violence dans le passé sont de nouveau au pouvoir.

Il y a quelques semaines, à propos du meurtre de 14 personnes par la police, précisément lors de manifestations contre la violence policière à Bogotá, Álvaro Uribe a écrit sur Twitter: «Mieux vaut couvre-feu du gouvernement national, forces armées dans la rue avec leurs véhicules et leurs automitrailleuses, expulsion des étrangers vandales et capture des responsables moraux. Mieux (ce qui précède) que les policiers morts, blessés, la destruction de bâtiments des CAI[1], risques pour le Transmilenio[2] ». Ce sont là les éléments de la xénophobie partisane, la création de l’ennemi intérieur et la militarisation de la politique que vous avez mentionné plus tôt?
F. F. : Je dirais qu’avec les idéologies fascistes, on constate, d’une part, la criminalisation de toute opposition ou plutôt de toute option alternative, et cette criminalisation va de pair avec la militarisation de la politique, qui est un élément central du fascisme. Dans le populisme, cet appel au militaire intervient au niveau discursif, mais pas au niveau pratique. Perón pouvait parler des soldats péronistes, ou il pouvait qualifier l’opposition d’ennemie de la patrie, mais il n’y avait aucune pratique qui corresponde à ce discours. Quand il y a criminalisation de l’ennemi et militarisation de la politique, incluant des éléments xénophobes, il est légitime de se demander si on est en train d’adopter des stratégies fascistes.
P. P. : Mais il y a quelque chose d’important. Ce que vous voyez en premier, ce n’est pas un État formant des groupes de choc et les envoyant dans la rue. Ce qui se passe, c’est que le gouvernement utilise des institutions étatiques qui emploient légitimement la violence pour militariser la politique. Ces forces agissent comme des groupes paramilitaires qui servent de catalyseurs à la violence. Aux USA, par exemple, le gouvernement a utilisé le Département de la sécurité intérieure, qui peut arrêter des personnes au mépris des procédures légales pour absence de papiers, et a étendu ces pratiques aux rues de certaines villes contre les manifestants. Parallèlement, on incite des milices civiles armées à faire le sale boulot, ce qui entraîne davantage de violence. S’appuyant sur ce désordre créé d’en haut, le gouvernement fait une démonstration de fermeté que la société peut estimer nécessaire lorsqu’elle a gobé les mensonges fascistes sur l’ennemi intérieur.
Si vous regardez l’histoire de l’Allemagne, et aussi de l’Italie, la violence de rue, par exemple, a été l’une des premières étapes de la montée d’un mouvement fasciste, destinée selon eux à frapper les communistes. La violence visible dans les rues a été un moment très important dans la montée du fascisme. Aux USA, l’incendie d’églises et de mosquées noires, les fusillades dans les rues, le meurtre d’immigrants et de noirs et les menaces contre les journalistes ces derniers mois ne doivent pas être ignorés. Ces stratégies peuvent aboutir à une dictature. Les dictatures qui se sont installées en Italie en 1922, en Allemagne en 1933 et en Argentine en 1976 ont été précédées d’actes de violence apparemment spontanés, mais inspirés par l’État. Les agences qui les ont organisés ont maintenu et augmenté leur pouvoir par la suite : le Fasci di Combattimento en Italie, les SA puis la SS en Allemagne ou la Triple A [Alliance anticommuniste argentine, de Lopez Rega] de l’Argentine péroniste. L’État de droit devrait mettre fin à ces actes, mais si un parti domine toutes les institutions de l’État, cela a peu de chances de se produire.
Mais la chose la plus importante ici, et qui fait partie de l’expérience du fascisme, est que toute cette violence est déployée contre une menace qui n’existe pas ou qui n’est pas aussi grande que le prétendent les fascistes. Il n’est pas vrai qu’Antifa est sur le point de prendre le contrôle des villes aux USA, ni que le « castro-chavisme », comme ils l’appellent, est sur le point de s’emparer de la Colombie, mais c’est la menace utilisée par les fascistes, et c’est clairement une menace pour la démocratie.

“Ils sont en train de nous tuer”: fresque murale, Medellín, septembre 2020
Je voudrais demander à Pablo comment ce mensonge fasciste se rapporte à l’élimination de la sphère publique qu’il a étudiée et, bien sûr, à la démocratie.
P. P. : Selon ce que tu as mentionné tout à l’heure sur les tweets d’Uribe : ce qu’il fait— comme le fait Trump ou l’a fait Calderón au Mexique — est de montrer qu’il y a une relation directe entre le peuple et le leader, et que tout ce qui contredit le leader (que cela provienne de la presse, de la science ou de l’opinion des autres) est un mensonge. Trump a dit que l’épidémie n’existait pas, que c’était un mensonge, et beaucoup de gens l’ont cru et ont fini par tomber malades. Ce serait évidemment la preuve factuelle qu’ils avaient tort, mais même ainsi, Trump n’a pas perdu son autorité sur ses partisans.
Ce qui se passe, et que nous voyons, c’est une tentative de saper la sphère publique, c’est-à-dire la possibilité d’un débat public, de distinguer la vérité du mensonge. On privilégie alors des formes de communication qui ne permettent pas le dialogue ou la confrontation des faits. Ce qui se passe maintenant aux USA, au Mexique avec la droite et aussi en Colombie, c’est que ceux qui sont au pouvoir disent: « Nous allons lancer une affirmation provocatrice, peu importe si c’est un mensonge. Notre public le croira, il n’y a même pas besoin de transformer la réalité, ils la transformeront eux-mêmes. »
 Médiamensonges, par Jorge Alaminos
Médiamensonges, par Jorge Alaminos
Quel rôle les médias jouent-ils dans cette extinction de la sphère publique et dans la montée et la normalisation éventuelle d’un discours fasciste ?
P. P. : Les médias, au moins aux USA, sont complices de ces stratagèmes car ils reproduisent les provocations de Trump et de ses partisans sans critiquer leur intention de désorienter et de distraire au moyen du mensonge. Les médias couvrent le discours de Trump comme s’il s’agissait du discours de tout autre politicien. Les médias les plus libéraux — journaux et télévisions— le font avec quelques mises en garde, mais partant de l’’idée que les médias doivent être « équilibrés » , ils considèrent que Trump doit être entendu comme si les mensonges équivalaient à la vérité. Dans ces cas-là, traiter l’actualité en essayant de préserver « l’équilibre » est un piège, c’est une erreur de couvrir un mouvement politique bâti sur des mensonges. Ce que font les médias, c’est donner aux mensonges une couverture aussi large qu’à des positions appuyées sur des faits. Poser la caméra devant l’un de ces dirigeants ou devant un membre de son parti, et le laisser parler pendant une heure sans rien corriger, et sans dire à quel moment il a menti, aide beaucoup à rendre acceptables les idées fascistes. Les médias doivent abandonner cette idée que tous les politiciens sont également respectables et dignes de foi, et les couvrir d’un œil plus critique. Certains journaux usaméricains ont récemment commencé à écrire dans leurs titres « Trump a dit cela, mais c’est un mensonge », mais pendant trois ans, ils n’ont dit que « Trump a dit ça».
 “Les faits sont les faits. Mais ils ne se voient pas, parce qu’ils les interprètent”- El Roto
“Les faits sont les faits. Mais ils ne se voient pas, parce qu’ils les interprètent”- El Roto
F. F. : Je suis d’accord avec Pablo. La seule chose que je veux ajouter, c’est qu’historiquement, lorsque le fascisme triomphe, les médias indépendants, qui basent leurs informations sur des faits et s’opposent bien sûr à la propagande et des mensonges totalitaires sont détruits. Dans ces situations, l’obligation, l’engagement civique et démocratique des médias, est d’essayer de contrer ce type de mensonges. Autrement dit, ils doivent faire leur travail.

Médiamensonges, par Juan Kalvellido
Pour conclure, est-il légitime, nécessaire ou plutôt dangereux d’utiliser le terme fascisme pour essayer de comprendre ce qui se passe aujourd’hui aux USA ou dans les pays d’Amérique latine que vous avez mentionnés, et pour comprendre ce qui se passe aujourd’hui en Colombie ?
F. F. : Le fait qu’il y ait des mensonges, ou un parti unique, ou des secteurs paramilitaires, même qu’il y ait une dictature, n’implique pas l’existence du fascisme. La question que nous devons nous poser est donc de savoir si toutes les conditions dont nous avons parlé impliquent nécessairement ou coïncident avec une stratégie ou une politique fasciste et s’il est possible que certains optent pour le fascisme en ce moment, par exemple en Colombie. Ce que je veux dire, c’est que bien qu’on ne puisse pas parler, à mon avis, de fascisme en Colombie ces dernières décennies, ce que l’on peut faire, en raison de l’existence constante de tous ces éléments antidémocratiques que nous voyons, c’est d’affirmer qu’il est possible que le un danger du fascisme existe évidemment en Colombie.
P. P. : Cette distinction entre le fascisme en tant que régime, le fascisme en tant que mouvement politique et le fascisme en tant qu’idéologie est importante. Je pense qu’il est important d’utiliser le concept de fascisme, et de comprendre l’histoire du fascisme. Non pas parce que nous pouvons prédire ce qui va se passer, mais pour comprendre les schémas qui ont conduit à l’émergence des régimes fascistes. Autrement dit, le fait que nous ne puissions pas appliquer le concept point par point ne signifie pas que nous ne pouvons pas penser à la possibilité que le projet politique de Trump, Bolsonaro ou Uribe soit cohérent avec le fascisme. Il me semble que refuser de penser qu’il existe un modèle visible dans les fascismes connus et reproductible dans les nouveaux, c’est délibérément ne pas voir cette possibilité et ce danger.
NdT
1- CAI : Les Comandos de Acción Inmediata sont des brigades d’intervention rapide de la police colombienne. Les policiers qui ont tué Javier Ordoñez le 8 septembre dernier en faisaient partie.
2- Le TransMilenio est le système de transports en commun par bus de Bogota, en grande partie en site propre (disposant de voies réservées)
Constanza Castro Benavidez
Traduit par Jacques Boutard
Edité par Fausto Giudice Фаусто Джудиче فاوستو جيوديشي
Source: Tlaxcala, le 25 octobre 2020



 Constanza Castro Benavidez; Historiadora de América Latina y de Colombia en el siglo XIX, investigadora y profesora de la Universidad de los Andes. Su investigación gira alrededor de problemas como la cultura política y la formación del Estado, la historia social de la ley, la historia social de la economía y las instituciones económicas, y la circulación de ideas políticas. Trabaja también en problemas que analizan la dimensión espacial de procesos económicos y sociales, en particular de la economía de mercado y el capitalismo en el siglo XIX.
Constanza Castro Benavidez; Historiadora de América Latina y de Colombia en el siglo XIX, investigadora y profesora de la Universidad de los Andes. Su investigación gira alrededor de problemas como la cultura política y la formación del Estado, la historia social de la ley, la historia social de la economía y las instituciones económicas, y la circulación de ideas políticas. Trabaja también en problemas que analizan la dimensión espacial de procesos económicos y sociales, en particular de la economía de mercado y el capitalismo en el siglo XIX.